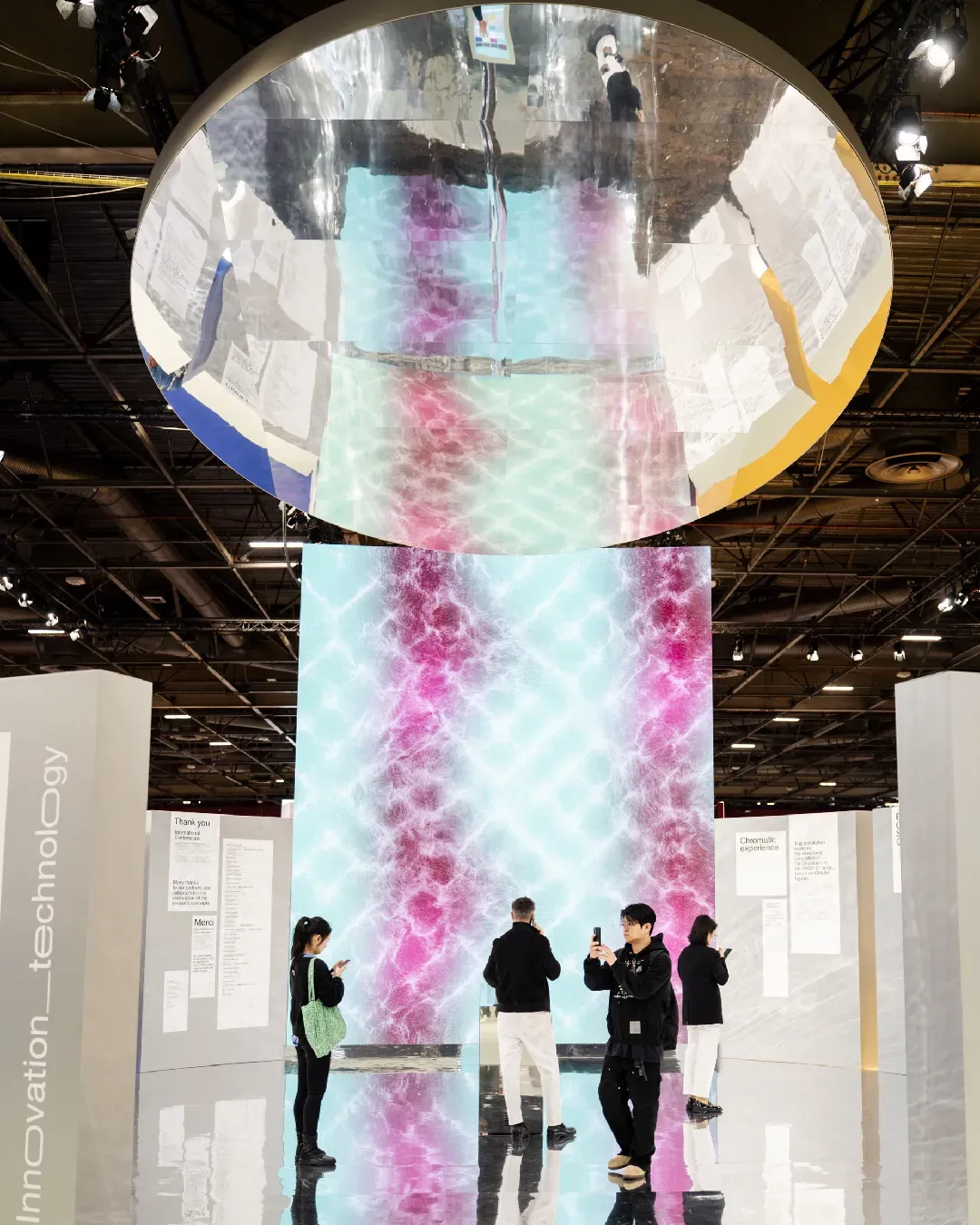"The Mastermind" est le film de braquage des années 1970 par excellence avec Josh O’Connor Un film qui bouleverse le genre et porte la signature reconnaissable de Kelly Reichardt
Josh O’Connor est vraiment partout. En attendant de le voir dans le prochain film du maître Steven Spielberg, et alors qu’on l’a déjà aperçu dans le rôle du prêtre du troisième volet de la saga mystérieuse Knives Out, à la 78e édition du Festival de Cannes il a endossé un double rôle. D’un côté, sous la direction d’Oliver Hermanus, il incarne l’amant de Paul Mescal dans le drame d’époque History of Sound, et à la clôture de la compétition cinématographique française, il est le voleur d’art protagoniste du dernier film de Kelly Reichardt The Mastermind. L’autrice américaine signe un film de braquage au rythme très personnel, reconnaissable dans l’écriture et la réalisation de cette œuvre se déroulant dans les années soixante-dix. Une relecture du genre qui rend ce titre assimilable au reste de sa filmographie, tout en racontant le casse bancal et chancelant du protagoniste James (O’Connor), bien planifié mais qui finit par tourner complètement au désastre.
@mubi It’s not stealing if you don’t get caught. New clip of Josh O'Connor in Kelly Reichardt's THE MASTERMIND. World premiering in competition at #Cannes2025 original sound - MUBI
En assouplissant le rythme habituel des récits de braquage – généralement trépidants et haletants – et en allant exactement dans la direction opposée en allongeant les temps et sans susciter (volontairement) aucune excitation ni adrénaline, The Mastermind devient simplement un résumé de tout ce qui peut mal tourner, ne manquant pas de déjouer les attentes. Alors que le protagoniste James est convaincu que tout se déroulera parfaitement, le scénario prend le contre-pied attendu, tout comme le ton utilisé, réalisant une œuvre à contre-courant qui détend au lieu d’électriser, avec une touche d’ironie typique des imprévus. O’Connor est méfiant, presque aveuglé par ses propres illusions, et organise un vol de tableaux dans un musée comme s’il s’agissait de la chose la plus facile au monde. Pas de souci, pas de conséquence. C’est cette illusion qui le rendra aveugle tout au long du film – on pourrait dire sa « chimère », pour citer l’un de ses grands rôles au cinéma – au point de voir s’écrouler toutes ses certitudes, l’une après l’autre.
D’abord le mauvais choix des complices, puis un mariage qui est en train de le réduire en miettes. The Mastermind est un exemple d’obstination nuisible ; c’est croire que sa propre vie vaut plus que celle des autres, à l’image de la valeur des œuvres d’art qu’il dérobe. C’est vouloir rendre sa propre existence à la hauteur de ces pièces nées de la créativité d’un artiste, pour ne pas se contenter de finir ses jours assis derrière un bureau. Il ne s’agit pas d’amour de l’art en soi, ni même d’une disposition. C’est la tentative, parfois désespérée, d’un homme qui refuse de se contenter, mais qui ne possède pas les outils nécessaires pour inverser les caprices du destin. Un destin que la main de Kelly Reichardt n’a aucune intention de favoriser. Dans le tourbillon de coïncidences malicieuses qui s’abattent sur le James d’O’Connor, The Mastermind est un petit conte moral – sans jugement ni leçon – sur l’homme qui veut plus que ce qu’il a, alors qu’il est déjà né dans une bonne famille, a eu deux enfants, et aurait pu aspirer à quelque chose d’autre sans tenter d’être autre chose qu’un petit voleur maladroit. C’est un film qui ne passionne pas ni ne captive fermement le spectateur, on regarde tout de même avec amusement le destin du protagoniste, qu’il retiendra ainsi : comme une info sur un braquage d’art raté et maladroit dont on entend parler dans un journal, puis qu’on oublie aussitôt.