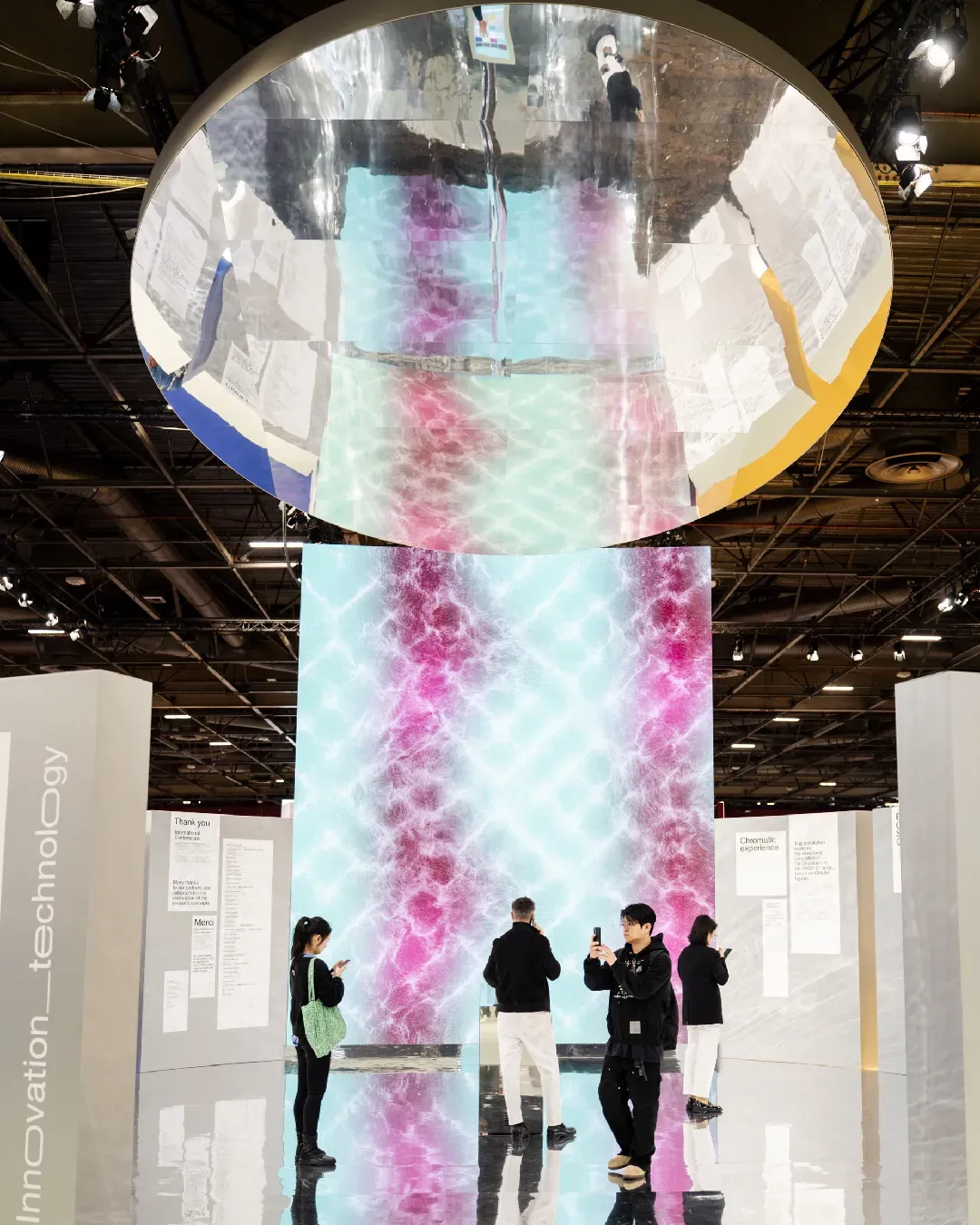"Die, my love" est un voyage chaotique mais évocateur dans la dépression post-partum Jennifer Lawrence et Robert Pattinson sont les protagonistes du film de Lynne Ramsay
Le cinéma nous a tant de fois raconté ce qu’est la maternité. Être enceinte et attendre un enfant, les joies et les douleurs de la parentalité, le sentiment d’euphorie et d’abattement qu’elle apporte. Mais il existe un sentiment qui est resté plus caché, réduit au silence comme il arrive souvent aux femmes qui s’y retrouvent confrontées. Une sorte de honte, à garder secrète, au point d’avoir longtemps été un stigmate dont il valait mieux ne pas parler : la dépression post-partum. Puisqu’il s’agit d’un état difficile à comprendre même pour les femmes qui en souffrent, c’est un mal extrêmement compliqué à raconter sur grand écran, à travers des mots et des images. Il faut de l’aide, quelqu’un à qui se confier, capable de comprendre tant de détresse sans jugement. Deux œuvres ont récemment tenté d’en dessiner un schéma : l’analyse minutieuse du documentaire Witches d’Elizabeth Sankey et l’adaptation du roman d’Ariana Harwicz, Die, My Love de Lynne Ramsay. Offrant son témoignage en première personne et invitant amies, collègues et “patientes” rencontrées sur son parcours, la Britannique Sankey propose une diapositive vive et sincère, parfois douloureuse, d’un moment censé être l’un des plus heureux dans la vie d’une femme et qui la conduit pourtant jusqu’à la perte de son Moi. En établissant un parallèle avec l’histoire des sorcières, le documentaire n’épargne ni les mères qu’il interroge, ni sa propre réalisatrice. C’est précisément ainsi que le spectateur reste abasourdi par les expériences qu’elles ont dû affronter et pour lesquelles tant d’autres avant elles ont été accusées de tous les maux, d’être des sorcières jusqu’à de mauvaises mères. Même s’il n’y a pas de rédemption, car ce n’est ni ce qu’Elizabeth Sankey ni ces femmes devraient recevoir, leur destin est aux antipodes du feu qui brûle en la protagoniste Grace, interprétée par Jennifer Lawrence dans Die, My Love.
Devenue mère et ayant abandonné sa carrière d’écrivaine, la protagoniste de Die, My Love sombre dans un état de psychose et de délire que la réalisatrice Ramsay accentue par un montage désarticulé et une confusion sonore constante. Grace s’occupe toute la journée de son enfant tandis que sa vie se répète inlassablement, jour après jour, avec son mari Jackson (Robert Pattinson) qui ne veut plus la toucher et partage son temps entre son travail et ses infidélités. La narration de l’adaptation du roman de Harwicz est indomptable et brouillée, à l’image de l’esprit de la protagoniste qui se délite progressivement. Aux frénésies et aux bruits de passion entre Grace et Jackson se substituent le murmure incessant des arbres autour de la maison isolée du couple et le crissement des grillons qui transperce l’ouïe du spectateur. L’importance donnée au travail sonore par Ramsay vise à étourdir immédiatement le public et à l’introduire dans l’état confusionnel de la protagoniste, pour rendre sa descente dans la perte de santé mentale, une perte que la femme est la première à refuser d’accepter. Die, My Love devient fragmenté, un assemblage de scènes et de moments qui assomment le spectateur. C’est la traduction en images de l’état de sa protagoniste et, tout comme cela arrive à Grace, finit par échapper à Lynne Ramsay, sans toutefois jamais perdre l’aura évocatrice qui résonne et réverbère dans les séquences segmentées.
La maternité de Grace n’est pas diabolisée, au contraire, son désir d’être une bonne mère est évident. On discute de combien de temps et à quel moment tenir son enfant dans les bras, combien le laisser pleurer, du fait qu’une mère devrait savoir préparer le gâteau pour son anniversaire. Mais tout comme les instincts sexuels primitifs et vibrants qui se manifestent, et sur lesquels Grace finit par perdre le contrôle, il en va de même pour une folie que dans Die, My Love l’écriture ne cherche jamais à reproduire, laissant aux images le rôle de seul moyen d’expression. La parentalité féminine est avide et furieuse, animale comme celle d’Amy Adams dans Nightbitch, qui ne traitait pas directement de la dépression post-partum, mais évoquait tout de même la privation de soi, remplacée par le seul rôle de mère, cherchant dans la connexion avec sa part animale son centre et sa liberté. Le film tout entier repose sur les épaules de Jennifer Lawrence, sur ses sautes d’humeur, sur ses demandes silencieuses et inachevées d’aide, aussi nécessaires que souvent méprisées. Et si l’absence de frein imposée par Lynne Ramsay est la force explosive avec laquelle Die, My Love peut submerger, c’est aussi celle qui fait parfois dévier le film incendiaire, surtout lorsqu’il ne parvient pas à équilibrer les anti-climax répétés qui donnent un rythme discontinu à l’œuvre, imparfaite certes mais courageusement démesurée, assurément furieuse comme l’acte de mettre quelqu’un au monde.